Incendies dans l’Aude, à Marseille, cyclone tropical à Mayotte, canicules à répétition, maladies, pollution : les conséquences du dérèglement climatique sont plus vives que jamais. L’urgence est là, face à nous. Notre maison continue de brûler, et plutôt que de redoubler l’effort pour contrer les effets dévastateurs de la crise écologique, les pouvoirs publics français et européens semblent se résigner à la fatalité. Face à cette course folle, nous avons le pouvoir de dire non à l’épuisement de la planète et à la résignation collective, afin de rouvrir le champ des possibles. Ce climato‑défaitisme, mal rampant qui sape les volontés et désarme les peuples, est aujourd’hui l’un de nos plus grands dangers. Jusqu’à la fin de l’été, je vous propose une série de chroniques pour tenter d’identifier ensemble les solutions. Après avoir traité la question de l’adaptation du territoire, de l’économie et de la santé, voici le dernier épisode : « Pour un ordre climatique mondial ». À l’échelle internationale, le climat n’est plus seulement une donnée scientifique : il est désormais un enjeu de sécurité collective, reconnu jusqu’au Conseil de sécurité des Nations unies, et s’impose comme l’un des déterminants de la stabilité au XXIᵉ siècle.
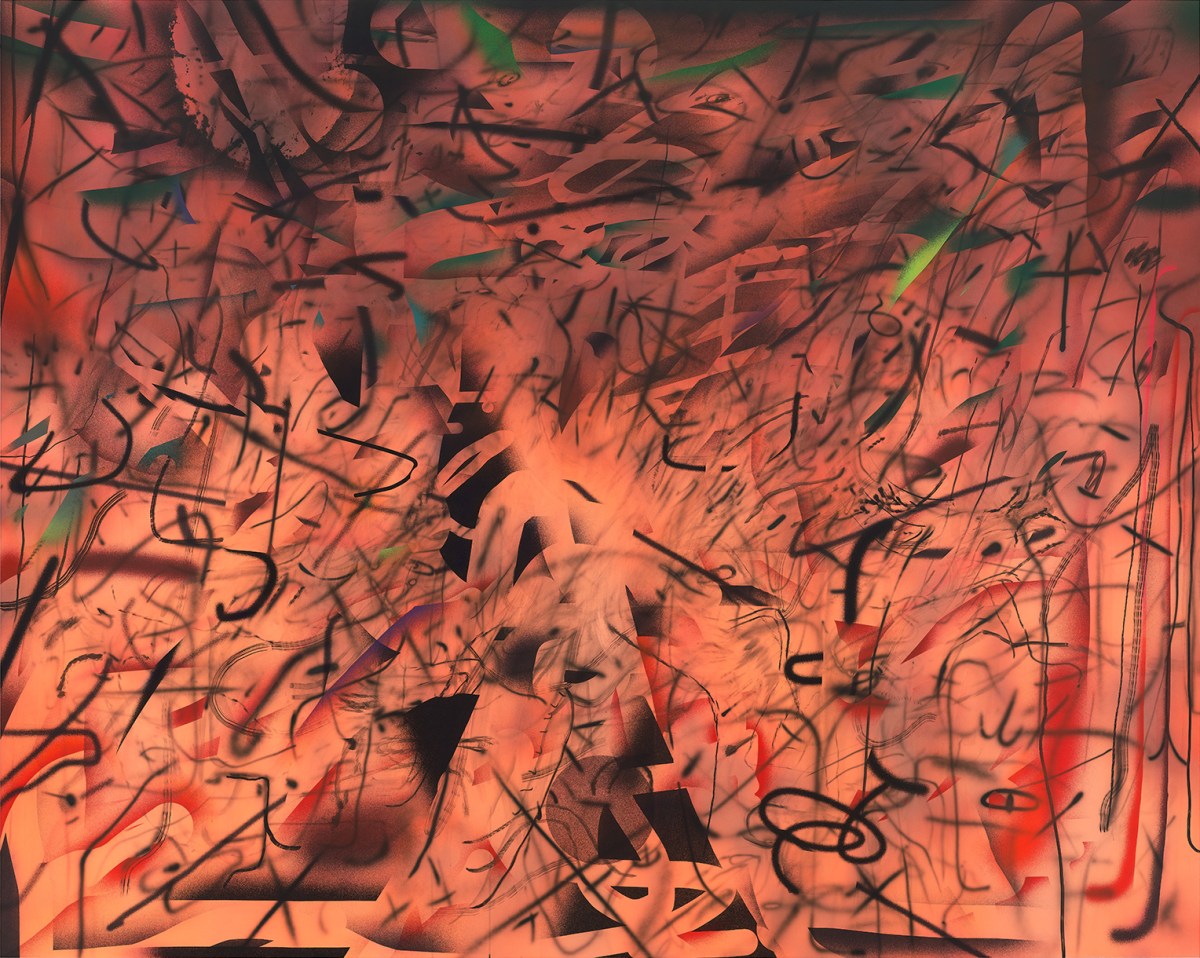
Gondawa. C’est le nom que René Barjavel donnait en 1967 à la civilisation humaine antique dont il peignait l’effondrement dans son ouvrage majeur La Nuit des temps. Livre d’anticipation, de science‑fiction, critique d’un monde moderne qui déjà s’avançait, trente ans avant le nouveau siècle, vers son essoufflement, l’histoire d’Éléa et Simon nous apparaît aujourd’hui comme le miroir de notre humanité. À l’apogée de son avancement scientifique et technologique, Gondawa s’effondre 900 000 ans avant notre ère, anéantie par une guerre totale qui aboutit à l'écroulement de la société. Elle avait bâti sa prospérité sur une formule scientifique et métaphysique secrète, l’« équation de Zoran », source d’énergie universelle qui permet de produire de la matière de façon illimitée et d’assurer ainsi l’abondance. La plume de Barjavel pointe ici une contradiction des sociétés humaines : plutôt que de mettre en commun les ressources, les énergies, les savoirs des peuples et des nations pour percer le secret de l’équation — permettant ainsi à l’humanité tout entière de bénéficier de ressources illimitées et d’une vie digne —, l’auteur met en scène des gouvernements qui préfèrent se faire la guerre pour tenter d’en monopoliser la maîtrise. À notre tour de répondre à cette contradiction. Pour progresser, posons une nouvelle équation : non plus celle de l’illimité prométhéen, mais celle des limites partagées ; non plus celle de la domination, mais celle de la cohabitation des peuples.
Relire Barjavel aujourd’hui, c’est percevoir âprement les douleurs du monde et de notre siècle. Le dérèglement climatique accélère la quête incessante de nouvelles ressources, renforçant les terrains de conflits et la violence des armes là où nous devrions collectivement nous atteler à bâtir un ordre climatique durable, capable d'organiser la gestion collective de nos ressources. La sécurité des peuples, des nations, des sociétés humaines en dépend directement.
C’est dans ce contexte qu’il nous faut travailler collectivement pour affirmer une doctrine géopolitique nouvelle. Face à des empires qui parlent fort et éructent leur toute‑puissance, la France et l’Europe ne peuvent se contenter de rester dans la componction et la mesure contenue. Les États‑Unis ont construit leur situation monopolistique sur la conviction de l’illimitisme ; pensant que l’innovation et l’avancement technologique permanent leur permettront de conjurer les limites planétaires — quitte à abonder dans le sens du transhumanisme —, ils persistent dans un modèle de prédation dont ils ne semblent pas décidés à sortir. De l’autre côté du globe, la Chine poursuit dans sa logique de contrôle et d’adaptation autoritaire. Ces modèles, qui laissent peu de place aux droits des peuples, les engagent dans un « pas de deux » mortel que l’Europe semble condamnée à regarder de loin.
Nous devons entrer à nouveau dans la danse. Pour cela, notre réponse doit être claire, en nous appuyant sur ce qui nous a toujours distingués à travers l’histoire : notre culture de la raison, de la coopération, de la considération du réel et de la démocratie. De là découle ce qui a fait notre force séculaire : la régulation, la loi, les règles que nous choisissons collectivement de nous fixer ne sont pas une fin en soi, mais les outils qui permettent de transformer un modèle, de faire émerger une culture et un système de société. Aujourd’hui, nous devons travailler pour faire émerger, face aux empires de l’illimitisme, une culture de la bifurcation, une philosophie des seuils et des limites. Il en va de la survie de l’humanité dans un monde où les ressources se raréfient.
Affirmer cette nouvelle doctrine humaniste, c’est partir du réel et porter une conscience accrue du monde et de ses réalités. La crise environnementale redessine les cartes de la géopolitique, en multipliant les points de friction sur toute la planète. Eau, énergie, terres cultivables, métaux rares, minerais stratégiques : les symptômes du désordre sont déjà visibles et précis. Je me retrouve dans le terme « Anthropocène », cette ère qui conduit l’humanité à devenir une force géologique : canicules inédites, mégafeux, cyclones et montée des eaux dessinent une géographie nouvelle du risque et de la puissance.
Dans l’Est de la République démocratique du Congo, l’exploitation du coltan, du cobalt, du tungstène, de l’or illustre avec acuité la manière dont des ressources indispensables peuvent nourrir la violence et devenir des revenus de guerre. Les milices et groupes armés captent la valeur, fragilisent l’autorité publique locale, terrorisent les populations, forcées de travailler pour l’extraction sans percevoir les bénéfices concrets de la richesse de leurs sols. Cet exemple montre combien, partout dans le monde, l’économie extractive brutale appauvrit des territoires qui devraient au contraire bénéficier de ces richesses. Du corridor de Lobito aux partenariats européens avec le Chili et la République démocratique du Congo, les accords de traçabilité et de chaînes de valeur responsables doivent devenir la norme ; ainsi seulement pourrons‑nous aligner les objectifs convergents de transition énergétique et de justice sociale.
L’eau elle-même est devenue un enjeu géopolitique majeur. Les « guerres de la soif » ne sont plus lointaines si nous n’agissons pas rapidement pour créer enfin des mécanismes de partage et de redistribution. À la frontière de l’Égypte, du Soudan et de l’Éthiopie, le Grand barrage de la Renaissance (GERD) n’en finit plus de créer des tensions tant le contrôle de l’eau du Nil peut radicalement transformer la structure économique et sociale de ces pays. Après une cinquième phase de remplissage achevée en 2024, Addis‑Abeba annonce l’inauguration du barrage en 2025, sans accord tripartite juridiquement contraignant à ce stade. S’il faut reconnaître la légitimité des aspirations au développement des pays en amont, il nous faut en même temps construire des garanties juridiques et techniques pour les pays en aval. Dans un même mouvement, la multiplication des barrages en amont du Mékong a modifié le régime hydrologique et réduit l’apport de sédiments, mettant en péril les moyens de subsistance des populations en aval, au Vietnam et au Cambodge, et rendant plus difficile le voisinage avec la Chine et le Laos. Nous voyons des dynamiques similaires en Asie du Sud, entre l’Inde et le Pakistan, autour de l’Indus — dont le traité de 1960 a été suspendu par l’Inde le 23 avril 2025 —, ainsi qu’au Moyen‑Orient, autour du Tigre et de l’Euphrate, entre la Turquie, la Syrie et l’Irak. Comprendre la façon dont les conflits autour du contrôle de l’eau dans le bassin du Jourdain permet d’obtenir de nouvelles clés pour appréhender la relation entre Israël et les pays arabes voisins. Ainsi, le Premier ministre d’Israël lui‑même, Yitzhak Rabin, disait en 1992 : « Si nous réglons tous les problèmes du Proche‑Orient mais pas celui du partage de l’eau, notre région explosera. La paix ne sera pas possible. » La guerre des Six‑Jours, en 1967, a profondément transformé l’influence d’Israël dans la région ; en prenant le contrôle du Golan et de la Cisjordanie, elle se retrouve en position de force dans le contrôle des rives du Yarmouk et l’amont du lac de Tibériade. C’est un levier de puissance et de coercition qu’elle exerce sans relâche contre ses voisins, et un nouvel outil de domination sur le peuple Palestinien. Partout, l’eau révèle la nécessité d’une justice climatique : sans règles partagées, la pénurie attise les conflits, du Sahel à l’Asie centrale.
Sur un autre terrain, la guerre en Ukraine nous donne une démonstration claire de la manière dont l’énergie est devenue au fil des décennies un instrument de pression et d’influence. Depuis les premiers soubresauts de 2014, et plus encore depuis le 21 février 2022, la Russie a visé de manière répétée les infrastructures énergétiques ukrainiennes, tandis que l’Europe a accéléré la diversification de ses approvisionnements ; les importations de gaz russe par gazoduc vers l’Union européenne ont chuté d’environ 77 % entre 2021 et 2024, et l’explosion des gazoducs Nord Stream a révélé la vulnérabilité d’infrastructures critiques. L’effondrement ou la fragilisation de systèmes énergétiques — plus nécessaires encore en temps de guerre lorsque les efforts d’une nation sont engagés dans une bataille — déstabilisent des économies entières et ouvrent des marges de manœuvre pour l’extorsion politique. L’énergie devient ainsi l’épicentre d’une nouvelle géopolitique du climat : réduire la dépendance aux hydrocarbures et accélérer les renouvelables, c’est aussi réduire les motifs de guerre.
Les crises climatiques provoquent aussi des déplacements massifs de populations qui fragilisent des régions entières. Les inondations historiques du Pakistan en 2022 ont affecté environ 33 millions de personnes et illustré la capacité des chocs climatiques à créer, presque du jour au lendemain, des crises politiques et humanitaires de grande ampleur. À l’échelle régionale, ces migrations internes et transfrontalières génèrent des pressions sociales sur les territoires d’accueil, exacerbent la concurrence pour l’accès aux ressources — singulièrement l’eau et la terre — et sont le terreau fertile de tensions identitaires, du rejet, de la haine de l’étranger. Voilà de nombreuses années que les scientifiques alertent sur les conséquences concrètes du dérèglement climatique sur le volet migratoire. Ces flux, s’ils ne sont ni anticipés ni gérés, deviendront des facteurs d’instabilité durable. Ce « multiplicateur de menaces » impose d’intégrer les paramètres climatiques dans toute stratégie de prévention des crises et de protection des civils.

En 1945, au sortir d’une guerre qui avait affaibli durablement l’ordre mondial, les États ont su inventer des institutions et des règles communes pour éviter l’emballement destructeur, pour faire face au péril global qui menaçait l’ordre du monde. Nous sommes aujourd’hui parvenus à un point de jonction dans l’Histoire qui doit à nouveau mobiliser notre capacité collective à nous dépasser et à retrouver le fil et les principes fondateurs d’une paix durable. Celle‑ci devra prendre en compte l’impératif vert, parce que l’enjeu de la bifurcation écologique est devenu, nous l’avons montré, un enjeu de sécurité. Diversifier, décarboner, protéger les infrastructures, réinventer un modèle de gestion de nos ressources, créer une diplomatie climatique forte : voilà l’unique chemin que nous devons prendre pour vivre en paix sur une planète protégée. Le « Nouvel Agenda pour la paix » en discussion aux Nations unies va dans ce sens : faire de la stabilité climatique une composante de la sécurité collective. Notre diplomatie climatique doit devenir un enjeu identitaire et structurant, tissant des partenariats entre Nord et Sud au nom de l’efficacité et de la justice climatique.
Nous n’avons d’autre choix que de transformer la dynamique des conflits en dynamique de coopération. Si nous ne prenons pas collectivement conscience, à l’échelle de la planète tout entière, que nos guerres seront vaines dans un monde dévasté, et qu’il est urgent de lier explicitement la question de la sécurité des peuples et celle de l’écologie, nous laisserons la compétition s’en charger et nous sombrerons dans des logiques d’affrontement permanentes qui se nourrissent mutuellement. La sécurité écologique n’est plus une option doctrinale : elle devient le socle d’une paix durable.
Le changement de paradigme est impératif. L’écologie ne doit plus simplement être pensée comme un supplément d’âme, mais comme la condition de la paix. Cela signifie transformer notre culture géopolitique pour qu’elle intègre systématiquement l’angle climatique et écologique dans les analyses de sécurité et de prévention des conflits, et faire de la lutte pour la bifurcation écologique un outil structurant de diplomatie. La France, parce qu’elle a toujours montré dans son histoire sa capacité à être une puissance motrice des transformations du monde, a son rôle à jouer. Avec l’Europe, elle doit être une puissance post‑impériale exemplaire : exister par l'exemple et non par la force, par la proposition et non par l'imposition. Elle doit montrer la voie pour rassembler autour du nouvel ordre climatique. Ainsi, c'est le rôle de la France de catalyser des accords globaux et d'enrichir son action diplomatique pour servir de caisse de résonance à ce nouvel état d’esprit international. Comme ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, j’ai toujours cru à un principe simple qui a guidé mon action : la volonté politique, la cohérence autour de principes clairs, la capacité à initier des coalitions peuvent peser infiniment plus que des chiffres bruts lorsqu’il s’agit d’instaurer une nouvelle culture internationale. À ceux qui prétendent que la France « ne pèse que 1 % des émissions » et prétextent ce chiffre pour ne pas agir et attendre que les autres s'en chargent, rappelons l’expérience de 2015 : par l’Accord de Paris, notre diplomatie a montré que l’influence et l’entraînement peuvent changer l’histoire.
La construction d’un ordre écologique crédible et durable ne peut se contenter de discours, de résolutions bien écrites ou de déclarations d’intentions. Elle nécessite dès aujourd’hui de travailler à la création d’institutions nouvelles, de règles juridiques fortes et de mécanismes financiers incitatifs. Sur ce point, il faut sortir de l’entre‑deux des COP annuelles et construire enfin un instrument permanent, adossé à l’Organisation des Nations unies et à l’Organisation mondiale de la santé. Les organisations non gouvernementales et les associations écologistes défendent depuis les années 2000 la création d’une Organisation mondiale de l’environnement. Les Accords de Paris auraient dû nous donner l’impulsion nécessaire pour la construire à partir de l’élan français. Il est temps d'en faire une réalité. Cette organisation sera munie de pouvoirs de coordination, de suivi et, lorsque cela apparaîtra nécessaire, de sanction. Elle aurait pour tâche de définir des standards d’exploitation des ressources — pour éviter le pillage des minerais, l’épuisement des stocks halieutiques ou la déforestation illégale —, d’ériger des règles contre les fuites de carbone, d’harmoniser la régulation des produits toxiques, et de piloter un fonds multilatéral d’adaptation destiné en priorité aux pays et collectivités les plus vulnérables. Ce fonds devra compléter les dispositifs « pertes et préjudices » mis en place depuis la COP28, encore sous‑dotés, et s’articuler avec des instruments économiques tels que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne (CBAM) pour limiter les fuites de carbone. À moyen terme, un Pacte mondial pour l’environnement et la reconnaissance internationale d’un crime d’« écocide » donneraient une ossature juridique à cet ordre écologique. Nous pourrions aussi imaginer que cette institution nouvelle se dote, à terme et à l’image des casques blancs, d’un mécanisme international de protection civile des secours climatiques, qui permettrait d’intervenir vite et fort face aux catastrophes.
Pour faire émerger ce nouvel ordre international, nous devrons imaginer une architecture en cercles concentriques pour faciliter l’action directe sans attendre le temps long de la diplomatie. Imaginons un monde dans lequel le niveau international soit celui des règles générales, des normes et des mécanismes de financement ; le niveau régional, leur traduction en instruments adaptés aux réalités hydrologiques, culturelles, écologiques et sociales ; et, au niveau national, une multiplication des actions bilatérales pour construire la confiance par des accords concrets et reproductibles. Imaginons désormais que nous souhaitions agir pour l’avènement de ce monde : la France, plutôt que d’attendre que les 193 États de l’ONU entérinent une stratégie commune, peut devenir pilote et montrer par l’action concrète sa capacité d’entraînement. Elle peut par exemple prendre l’initiative de rassembler autour d’elle un noyau pionnier d’États volontaires, un « club climatique » réunissant des pays de l’Union européenne, des États du Sud global désireux de prendre le train de l’écologie mondiale, et construire à partir de ce premier cercle des standards ambitieux et prouver leur utilité. Ce noyau pourra s’adosser au Club climat du G7 et dialoguer avec des coalitions Sud‑Sud — y compris au sein de groupements émergents — pour accélérer la décarbonation de l’acier, du ciment et des industries lourdes.
Ces coalitions avec le Sud global sont au cœur de notre méthode. Il est essentiel de changer l’horizon de nos alliances pour ne plus être la variable d’ajustement, le cousin que l’on invite pour faire plaisir. Nouer ces alliances nouvelles et ambitieuses avec les pays émergents — des BRICS au Mercosur en passant par des coalitions africaines —, c’est sortir de l’étouffante étreinte des États‑Unis et de la Chine et retrouver de l’air pour imaginer un nouvel axe stratégique. Il ne s’agit pas ici de poursuivre dans l’aveuglement de canaux descendants, mais de faire du Sud global un partenaire d’innovation et de solutions, en privilégiant des coalitions plurilatérales associant États, collectivités et entreprises. Ce basculement est un enjeu philosophique et stratégique qui nous permettra de légitimer nos standards, d’ouvrir de nouveaux marchés pour des technologies sobres et de créer des mécanismes de financement et de transfert adaptés aux besoins réels des pays les plus vulnérables.
Notre pays, en montrant les résultats tangibles d’une doctrine géopolitique revisitée, peut créer un effet d’entraînement et permettre l’élargissement de ces nouveaux standards climatiques. Au‑delà de notre expérience diplomatique, nous sommes les héritiers et dépositaires d’un territoire unique au monde qui concentre, par sa géographie, toutes les ressources et tous les atouts pour s’imposer comme le pays pilote, organisateur et médiateur de ce nouvel ordre climatique. Nous avons le deuxième domaine maritime le plus étendu du monde et bénéficions d’une présence sur tous les continents, parfois au cœur des foyers de tension sur la gestion des ressources, dans les Caraïbes, dans le Pacifique ou dans l’océan Indien, par exemple. Notre plus longue frontière terrestre est avec le Brésil, ce qui donne à la France une responsabilité particulière dans la gestion de l’Amazonie, dont une parcelle se trouve sur notre territoire. Notre présence dans le Pacifique et l’océan Indien nous oblige, de surcroît, à porter la voix des petits États insulaires, en première ligne face à la montée des eaux.
Nous pourrons utiliser aussi notre ouverture à la Méditerranée comme un levier pour desserrer l’étau d’une logique purement atlantiste, en inventant une diplomatie de proximité avec l’Afrique et le Proche‑Orient. Le MedECC/PNUE considère que la Méditerranée, qui se réchauffe environ 20 % plus vite que la moyenne mondiale, est l’un des foyers les plus en crise face au dérèglement climatique ; d’ici 2040, au moins 250 millions de Méditerranéens pourraient devenir « pauvres en eau », ce qui aggraverait les tensions agricoles et les migrations intra‑régionales. Partir de la Méditerranée comme un nouvel épicentre des coopérations mondiales sur le climat, c’est donner à voir la puissance d’une diplomatie qui s’ouvre à nouveau vers le Sud global en rompant le rapport descendant et colonial. Il est temps de sortir des recettes éculées et de ces « sommets des deux rives » qui ne prennent pas en compte les spécificités d’un bassin composé, en réalité, d’au moins cinq rives aux enjeux et aux cultures différenciés : l’Europe du Sud, le Maghreb, le Machrek et la Méditerranée orientale, l’Afrique sahélienne et subsaharienne adjacente, la mer Égée et les Balkans. La Méditerranée peut devenir le laboratoire d’un pacte hydrique régional — gestion concertée des aquifères, réutilisation des eaux, agriculture économe — et d’un marché de l’énergie propre interconnecté.
Faisons de la Méditerranée le laboratoire de notre nouvelle doctrine, en rompant définitivement avec la logique paternaliste qui a trop souvent conduit nos pays européens vers l’erreur ; coopérer sans imposer, réfléchir ensemble, apprendre les uns des autres, nous inspirer aussi des solutions souvent innovantes mises en place par les pays émergents. La bifurcation écologique peut être pensée de deux manières : comme une contrainte douloureuse qui nous conduit aux stratégies punitives et à l’aggravation des tensions, ou comme une opportunité que nous pouvons saisir pour faire évoluer nos cultures du compromis, du consensus et de la coopération. En favorisant les projets de recherche internationaux, en renouant des liens diplomatiques avec l’ensemble des pays qui souhaitent agir de concert pour prévenir les conséquences dramatiques du dérèglement, en trouvant de nouvelles manières de gérer les fleuves, les mers, les forêts transfrontalières, nous saurons réduire les tensions, prévenir les crises et limiter les déplacements massifs de population qui se profilent si nous n’agissons pas.

Nous ne bâtirons pas, nous ne bâtirons jamais, un ordre climatique mondial en restant enfermés dans des logiques de puissance, en travaillant en vase clos avec nos partenaires européens et occidentaux comme seuls interlocuteurs. Nous avons un vibrant besoin de nous appuyer sur les pays émergents, qui portent désormais une part essentielle de la trajectoire écologique de la planète. La Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi pays le plus en pointe sur la question des technologies solaires et des batteries, tient entre ses mains une partie du destin commun de l’humanité. L’Inde, qui doit faire face à une croissance démographique et économique fulgurante, sera dans les décennies qui viennent l’un des arbitres du compromis essentiel entre développement et sobriété. Le Brésil, lui aussi, détient une responsabilité historique, et j’espère que la COP30, qui se tiendra à Belém du 10 au 21 novembre 2025, lui permettra d’affirmer une voie nouvelle. L’Indonésie, archipel majeur pour la biodiversité et acteur industriel et minier croissant dans la région, participe aussi de cette équation. Et ce sont ainsi des dizaines, des centaines de pays qui, par leur position stratégique, par les moyens qu’ils ont mis en place pour faire face aux conséquences concrètes d’un dérèglement climatique et d’une crise des ressources dont ils sont les premières victimes, ont acquis une expertise et une connaissance des sujets sur lesquels nous devrons nous appuyer et nous inspirer. Ces nations ne doivent pas rester spectatrices d’un monde qui a trop souvent changé sans elles. L’essor des coalitions Sud‑Sud — de l’Amazonie à l’Indonésie — peut devenir un moteur d’ambition partagée si nous savons bâtir des ponts de confiance et de financement. Plus encore, sans justice climatique et sans partage équitable des efforts entre le Nord et le Sud, la solidarité cède la place aux égoïsmes nationaux : une concurrence des survivances qui mettrait en échec tout ordre climatique.
Je reviens rapidement sur les enjeux de la COP 30 qui se tiendra à Belem cette année et qui doivent être une nouvelle étape historique, sans quoi nous serons à rebours de ce que commande le siècle.. Nous serons alors dix ans, quasiment jour pour jour, après les accords historiques de Paris. Le retrait des Etats-Unis, pour la deuxième fois, de la liste des signataires, est un mauvais signal, mais nous pouvons collectivement trouver les moyens de construire une nouvelle trajectoire financière pour tenir nos engagements. Il est temps de cesser les COP de négociation pour abonder enfin dans des COP de mise en oeuvre concrète de nos objectifs : investir au moins 300 milliards par an jusqu'en 2030 pour sortir des énergies fossiles. Ce moment doit être l'occasion pour la France de s'affirmer comme l'un des interlocuteurs premiers des Etats volontaires pour imaginer la suite. En signant en juin avec le Président Lula un communiqué commun, ambitieux et volontaire, le Président de la République s'est engagé au nom de la Nation tout entière, et nous attendons de lui qu'il concrétise ces déclarations d'intention en agissant véritablement pour une politique mondiale du climat revisitée et qui s'attache à faire respecter partout les deux jambes des promesses franco-brésiliennes : préservation de l'environnement et justice sociale.
Nous avons les moyens d’agir — et d’agir dès aujourd’hui — en proposant une conférence fondatrice pour l’Organisation mondiale de l’environnement, en lançant des coalitions sectorielles sur l’acier vert ou les batteries durables, en initiant des accords bilatéraux de traçabilité avec la République démocratique du Congo, le Chili ou la Bolivie, en multipliant les partenariats ciblés, en imaginant de nouveaux mécanismes régionaux de gestion de l’eau et de prévention des conflits agro‑pastoraux au Sahel et en Afrique de l’Ouest, en signant des traités de partage et d’arbitrage des eaux entre États riverains, et en développant des coopérations maritimes pour lutter contre la pêche illégale et encadrer la prospection minière en haute mer, en s’appuyant sur le traité « haute mer » (BBNJ), appelé à entrer en vigueur une fois atteintes 60 ratifications. J’ai acquis et construit une conviction depuis des années désormais : c’est au niveau bilatéral que se forment les pratiques de confiance et que nous nous donnons les moyens d’expérimenter des modèles susceptibles d’être montés en échelle. Dans ces accords bilatéraux, notre priorité stratégique doit être de nouer des partenariats d’égal à égal avec les pays du Sud global pour en faire des partenaires et des architectes de la bifurcation écologique, et non de simples bénéficiaires passifs.
Nous ne possédons pas, comme dans l’empire déchu de Gondawa, de secret ultime qui nous permette de produire en permanence de nouvelles richesses et de nouvelles matières premières. Ici, le réel se heurte aux frontières de l’imaginaire et de l’univers de science‑fiction imaginé par Barjavel il y a plus d’un demi‑siècle. Pour autant, nous avons construit nos sociétés et leur prospérité sur l’extraction de richesses dont nous nous sommes rendus dépendants et qui sont réparties de manière inéquitable sur la planète. Cette réalité est la nôtre, et elle est indépassable. Les logiques de prédation et d’exploitation ont conduit à des inégalités structurelles qui pèsent non seulement sur les pays en développement, mais désormais aussi sur les grandes puissances mondiales et continentales. Nous serons bientôt au point de non‑retour, où la contradiction historique qui a fait que, par la puissance des empires coloniaux, les pays disposant des terres les plus riches ont été rendus les plus pauvres et les plus dépendants par le jeu des guerres et des rapports de force ne fonctionnera bientôt plus. Retrouver une dynamique d’équilibre est un enjeu essentiel pour les pays extracteurs, qui doivent retrouver leur dû, mais aussi pour les pays importateurs. Nous assistons à une inversion de la chaîne de dépendance qui nous force à l’humilité. Aujourd’hui, le développement des pays du Sud global est essentiel à la prospérité des pays du Nord. La transition juste — qui associe décarbonation et réduction des inégalités — est la clef d’un équilibre durable.
Cela nécessite d’abord d’identifier et de sanctuariser des biens communs pour les faire sortir de la logique du marché. L’eau douce, les océans, les forêts et certains gisements miniers doivent être traités comme des communs à gouverner collectivement. Concrètement, cela implique des observatoires partagés et transparents pour les bassins fluviaux, des règles de prélèvement négociées et juridiquement contraignantes avec des certificats vérifiables, des régimes de protection pour les zones marines sensibles, et une nouvelle approche transfrontalière de gestion des ressources qui se situent à la jonction de deux territoires. C’est un enjeu économique et social, mais aussi un enjeu géopolitique, parce que le travail commun autour de ressources partagées permet d’apaiser les tensions et de favoriser des logiques de partage plutôt que des logiques de guerre et de conflits.
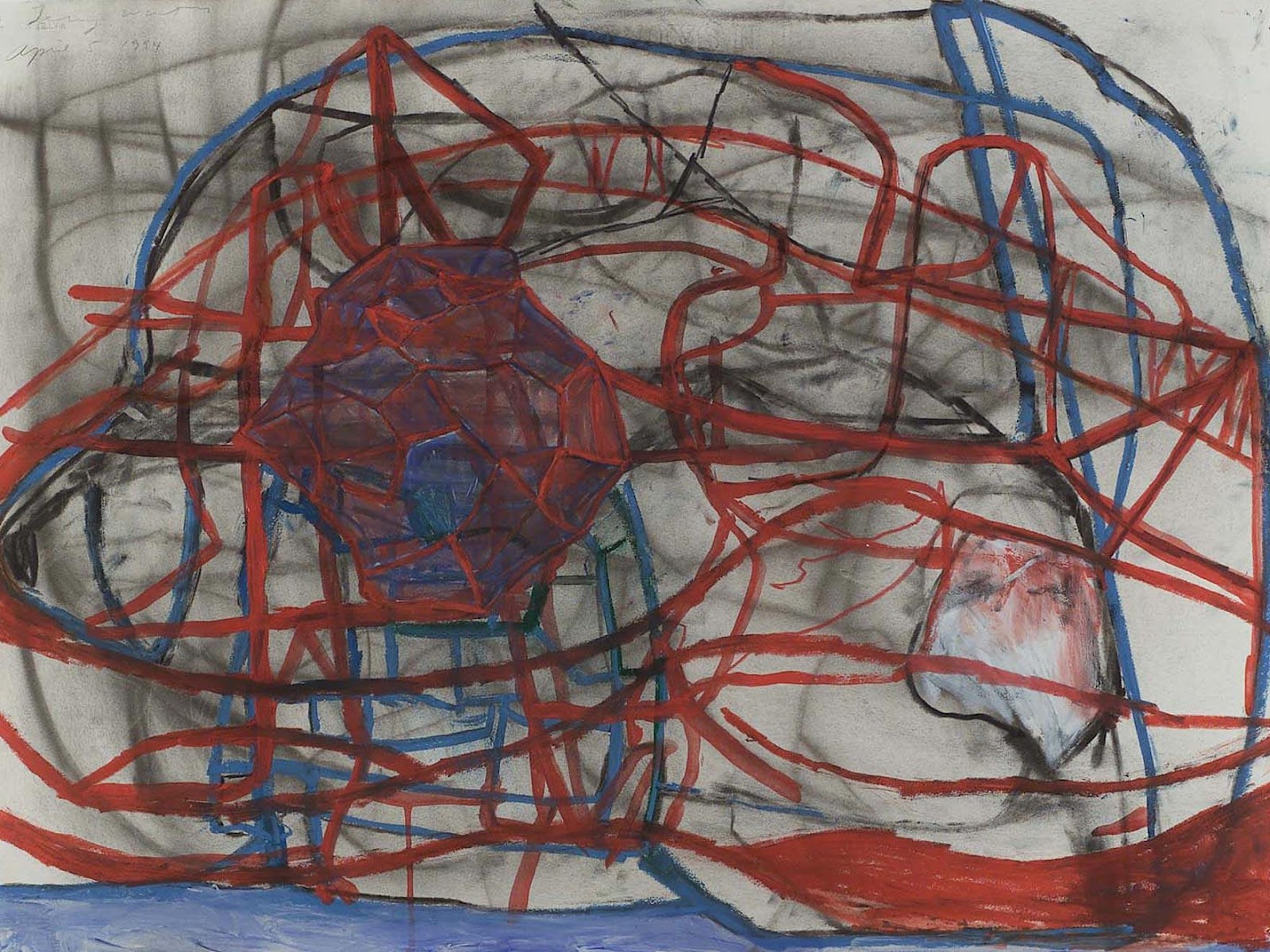
Rien de tout cela ne tiendra sans l’adhésion et l’effort de tous les acteurs de la société. Instaurer un ordre climatique international ne doit pas être l’apanage d’une poignée de négociateurs dans des sommets feutrés. C’est au contraire l’ensemble des forces vives de la société qui doivent se donner la main pour relever ce défi : entreprises, syndicats, collectivités locales, ONG, citoyens. Les États — et la France au premier plan — doivent être des forces stratégiques de mise en commun, et doter leurs nations d’outils de pilotage utiles et efficaces, qui permettent à chacun de mobiliser ses ressources et ses capacités d’action.
Le monde économique, pris dans le tourbillon infernal du néolibéralisme et de la mondialisation, a accéléré le dérèglement climatique et ses conséquences. Il lui incombe donc naturellement de réorienter son action au regard des impératifs du siècle. Les entreprises innovent, investissent et emploient ; sans elles, pas de transition technologique ni de nouvelle organisation du travail. Elles sont déjà rattrapées par les conséquences du dérèglement climatique. Centrales nucléaires ralenties en France pour respecter les seuils thermiques des rejets, champs détruits par les sécheresses, stations de ski fermées par manque de neige, usines en Chine mises à l’arrêt par le tarissement de l’hydroélectricité : tous les secteurs paient le prix fort — tourisme, industrie, agriculture, immobilier. Il est urgent de repenser des règles internationales claires pour éviter le dumping environnemental et garantir un cadre équitable : tarification mondiale du carbone, alliances sectorielles, transition verte de l’industrie. L’économie comprend qu’elle joue sa survie autant que l’intérêt général. Le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) montre la voie : demain, il devra s’inscrire dans un cadre multilatéral pour ne pas devenir un nouvel objet de discorde.
Les collectivités et les services publics sont en première ligne face aux catastrophes. Ce sont eux qui réparent après les inondations, qui relogent après les cyclones, qui luttent contre les feux de forêt, qui imaginent des solutions d’aménagement et d’adaptation des infrastructures pour contrer les canicules et le dépérissement de la biodiversité. Il est essentiel de les intégrer à l’ordre climatique mondial et de repenser la « diplomatie des villes ». Développer des partenariats entre universités, encourager les échanges culturels et touristiques autour des enjeux de la transition, partager les savoirs et les solutions : voilà des leviers concrets. Les réseaux de villes — du C40 au Pacte mondial des maires — sont déjà des pionniers ; soutenons‑les, et finançons directement les projets d’adaptation au plus près des territoires.
Surtout, nous aurons à nous appuyer sur le corps social, et sur les citoyens eux‑mêmes qui sont les moteurs de la transformation. Partout dans le monde, des femmes et des hommes se mobilisent par millions dans les marches pour le climat, intentent des actions en justice contre les pays qui pèchent par abandon, se constituent en collectifs puissants pour peser sur les grandes décisions et tenter d’inverser les tendances. Les jeunes générations, particulièrement, se dotent de figures fortes capables d’incarner cette nouvelle donne politique. Ainsi, Greta Thunberg, Camille Étienne ou encore Cyril Dion sont devenus les porte‑étendards d’une génération qui veut prendre le contrôle et transformer les structures. Placés en périphérie des partis politiques, ils ont vocation à agir en transversalité sur l’opinion publique et, par capillarité, sur les décideurs. Leur action est essentielle, structurante, parce que c’est en faisant vibrer la corde de la démocratie et en faisant peser sur les sphères dirigeantes le mouvement de la société tout entière — ces citoyens qui prennent conscience de l’urgence, que la santé, l’alimentation, les jouets de leurs enfants, la qualité de l’air de leur foyer — sont liées à des politiques ambitieuses et des règles internationales plus protectrices — que nous réussirons à créer le cadre de la bifurcation écologique. De « l’Affaire du Siècle » aux grèves scolaires pour le climat, la société civile a prouvé qu’elle pouvait ouvrir la voie ; aux responsables publics de transformer cet élan en décisions.
L’ordre climatique mondial sera à échelles multiples, sinon il est condamné à l’échec. La bataille des consciences est en train d’être gagnée, et le retour de bâton organisé sciemment par les forces les plus réactionnaires et conservatrices en est l’incarnation. La panique morale de celles et ceux qui veulent se contenter de l’inaction montre la force du mouvement des consciences. La prochaine étape est politique et diplomatique.
L’humanisme est une boussole, une doctrine nouvelle pour un monde en crise. Nous devons, parce que c’est notre vocation historique et la mission que nous nous sommes donnée, identifier en profondeur les causes structurelles qui sont à l’origine des grands bouleversements de l’humanité. C’est une exigence de rigueur, de raison et d’ambition.
Alors, regarder le monde en face, c’est se rendre compte de sa vérité simple et terrible. Nous sommes à la croisée des chemins, et il nous reste quelques années à peine pour choisir de quoi nous voulons faire notre destin : un siècle de conflits et d’exodes climatiques, ou un coup d’épaule nécessaire pour investir maintenant dans des institutions, des règles et des financements capables de transformer la rareté en gouvernance partagée. C’est un pari historique, existentiel. La France peut, et doit, retrouver ce rôle d’architecte d’un nouvel ordre climatique mondial. Il ne s’agit pas d’imposer ou de contraindre, mais de rassembler, de proposer des compromis acceptables et de montrer la voie par des initiatives concrètes. Réussir la bifurcation écologique, c’est gagner la paix au XXIᵉ siècle. Échouer, c’est condamner nos enfants — et leurs enfants après eux — à payer très cher l’addition de notre échec.
– Dominique de Villepin