Incendies dans l’Aude, à Marseille, cyclone tropical à Mayotte, canicules à répétition, maladies, pollution : les conséquences du dérèglement climatique sont plus vives que jamais. L’urgence est là, face à nous. Notre maison continue de brûler et, plutôt que de redoubler l’effort pour contrer les effets dévastateurs de la crise écologique, les pouvoirs publics français et européens semblent se résigner à la fatalité. Jusqu’à la fin de l’été, je propose une série de chroniques pour tenter d’identifier ensemble des solutions. Après celle consacrée à la grande adaptation du territoire et celle qui fixe l’écologie comme condition de la prospérité économique, en voici le troisième épisode : « Santé et environnement : pour une exception sanitaire française. »
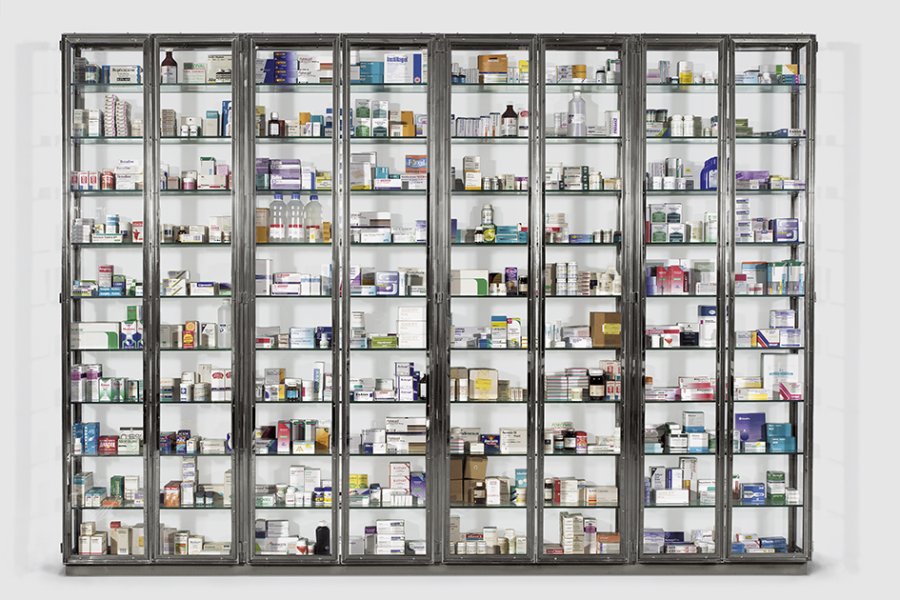
Ces dernières semaines, j’ai reçu des messages de journalistes : « Vous êtes devenu écolo, Monsieur de Villepin ? » Le sujet fait jaser dans les salles de rédaction parisiennes. Découvrent-ils que j’étais ministre dans le gouvernement de Jacques Chirac lorsqu’il a fait entrer la Charte de l’environnement dans la Constitution ? Que j’ai publié en 2009 un roman sur le monde après le grand effondrement ? Faut-il, d’abord, « devenir » écolo ? Ou suffit-il de porter un regard lucide sur le monde pour se rendre compte de l’ampleur du défi environnemental ? Je m’inquiète que la conscience du monde et de ses douleurs soit devenue une étiquette politique, alors que l’écologie ne devrait pas avoir de camp tant elle est la plus grande des transversalités. Je suis heureux d’avoir commencé cette série de chroniques pour essayer de traiter en profondeur ce sujet, parce qu’elle suscite le débat, elle étonne, elle crée de la réflexion. La bifurcation écologique n’est pas un programme politique ou une promesse électorale : elle est la condition de notre survie en commun. En tirant le fil de l’écologie, j’ai pu aborder avec vous la question de l’adaptation du territoire et de sa prééminence dans le domaine économique. Il me revient aujourd’hui d’ouvrir une autre porte : celle de la santé. Parce qu'une nation libre et solide, c'est une nation qui respecte les corps et leur environnement, qui protège ses citoyens et qui s'attache à leur garantir une vie digne à tous les moments de la vie. Nous avons bâti notre singularité historique sur l'exception culturelle française ; il est temps de bâtir une exception sanitaire française. Rendons à notre modèle sanitaire sa fierté, son exemplarité et sa grandeur pour le faire rayonner en Europe et dans le monde, pour donner à voir la capacité de la France à se relever et à faire figure d'exemple.
Là encore, le problème est structurel. Les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé sont alarmants : selon elle, 23 % des décès mondiaux sont attribuables à des risques environnementaux. En France, la seule exposition aux particules fines fait baisser de huit mois l’espérance de vie des plus de trente ans chaque année. Elle est responsable de 7 % des décès dans notre pays. À ce constat s’ajoutent les 33 000 décès liés à la chaleur entre 2014 et 2022. Et les premières victimes sont les plus précaires : exposition accrue aux grandes chaleurs l’été et aux grands froids d’hiver dans des appartements souvent mal isolés et plus petits ; contraintes alimentaires plus fortes et alimentation souvent plus industrielle, donc plus sujette aux pesticides et aux « polluants éternels ». Ces polluants éternels sont notamment les PFAS, des substances per- et polyfluoroalkylées qui s’accumulent dans l’environnement et dans l’organisme. À cela s’ajoute une plus grande difficulté d’accès aux soins. Cette précarité écologique est également accentuée pour les femmes et les hommes qui exercent des métiers industriels, ouvriers ou agricoles, exposés aux vapeurs chimiques et aux produits dangereux. Elle s’exprime aussi sur le plan psychique : l’anxiété climatique, les troubles du sommeil et la détresse post‑catastrophe affectent durablement les individus et les communautés.
« L’écologie n’est pas qu’un marqueur politique : protéger le vivant et agir contre les conséquences du dérèglement climatique, c’est protéger l’humain et l’humanité, et préserver notre cohésion sociale. »
Ces inégalités environnementales sont aussi des inégalités de genre. Sur le plan physiologique, nous savons que l'organisme des femmes concentre plus massivement les substances toxiques telles que les dioxines ou phtalates, ce qui accentue les risques de puberté précoce, d'endométriose, de cancers hormono-dépendants, de diabète. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) soulignait il y a quelques années l'exposition accrue des femmes aux produits dangereux contenus dans les protections hygiéniques : substances cancérogènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines, les furanes, substances reprotoxiques comme les phtalates ou encore substances parfumantes allergisantes, pesticides. Si le secteur des cosmétiques masculins est en plein essor, les femmes là-encore sont plus exposées au risque lié à l'usage des cosmétiques sur la santé et sur l'environnement.
Avec 15% de parts de marché, la France est le leader mondial du secteur cosmétique. Les produits de beauté font désormais partie de notre quotidien ; cela nécessite une vigilance accrue, tant l'impact sur l'organisme de produits directement appliqués sur la peau multiplient les risques s'ils ne sont pas drastiquement contrôlés. Les associations de protection des consommateurs recensent plusieurs dizaines de milliers de ces produits qui contiennent au moins un ingrédient indésirable, tels des perturbateurs endocriniens dont certains peuvent favoriser l'émergence de maladies et de cancers, perturber le système hormonal ou affaiblir les résistances immunitaires. Souvent rincés et évacués par la bonde des lavabos domestiques, ces produits ne se contentent pas de polluer la peau, mais aussi les eaux, les rivières, les ruisseaux. C'est une industrie qui par ailleurs génère de nombreux déchets: les emballages plastiques des cosmétiques représentent environ 75 000 tonnes jetés tous les ans en France, et les microplastiques issus de ces produits - gommages, huiles, fixatifs - ont des effets dévastateurs sur la faune et la biodiversité aquatique. Nous savons aussi que les méthodes de tests en laboratoire sont souvent épinglées pour la violence animalière qu'elles génèrent.
Il nous faudra, d'ailleurs, à échelle de toutes les industries, sortir progressivement du plastique. De plus en plus, le recyclage du plastique est remis en cause par les spécialistes. Il ne s'agit plus de prolonger la durée de vie de la matière, mais d'arrêter de la produire et de la consommer. Certains parlent de « bombe à retardement », tant son recyclage produit du carbone et génère des microplastiques qui viennent s'immiscer dans tous nos biens de consommation.

Dans le même temps, le dérèglement climatique apporte son lot de maladies nouvelles auxquelles les sociétés doivent apprendre à faire face. La pandémie de la Covid‑19, qui a mis notre pays et le monde à l’arrêt et a plongé des centaines de milliers de familles dans la douleur du deuil, nous a rappelé avec une acuité terrible combien la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont liées. Les déplacements d’espèces porteuses de virus font partie des risques inhérents à un climat qui se réchauffe à l’échelle planétaire ; à titre d’exemple, l’expansion du moustique tigre a entraîné, en quelques années, des épidémies de chikungunya, de dengue et de Zika, trois maladies jusqu’alors inconnues dans certaines régions du monde. Arrivé en Europe, y compris en France, ce vecteur expose désormais à des formes potentiellement mortelles. Selon les derniers chiffres gouvernementaux, l’espèce est installée dans soixante‑dix‑huit départements métropolitains, et la croissance des maladies dont elle est le vecteur est exponentielle : de 131 cas de dengue en 2023, on en dénombrait près de 1 700 en 2024 sur le seul territoire hexagonal, 4 700 dans tout le pays. Les premières épidémies infectieuses reconnues par l’Histoire datent de la sédentarisation des groupes humains au Néolithique ; désormais, la densification du monde, la métropolisation et la proximité accrue avec les animaux, domestiques comme urbains, créent les conditions d’une transmission de plus en plus rapide des maladies infectieuses. Plus de 60 % des maladies infectieuses humaines sont d’origine animale et plus de 75 % des maladies émergentes sont zoonotiques.
« L'exception sanitaire française est un nouveau cadre qui aura à traiter en profondeur les causes qui conduisent à la destruction combinée de notre santé et de notre environnement. »
Les risques environnementaux constituent sans conteste des déterminants majeurs de morbidité et de mortalité. Tout en aggravant les inégalités, ils menacent la résilience même de la nation, tant ils pèsent sur notre système de santé, déjà ébranlé par des défauts structurels chroniques et de nouveaux défis. Les schémas sont structurels et d’une mécanique terrifiante : les passoires thermiques créent de la précarité énergétique qui se traduit par une aggravation des maladies chroniques et une surmortalité lors des canicules. L’alimentation industrielle conduit à l’obésité et à ses comorbidités, et elle alimente les maladies liées aux produits toxiques introduits dans nos assiettes. L’assèchement de notre biodiversité et l’urbanisation créent les conditions de l’émergence des maladies zoonotiques. Dans ce cadre, non, l’écologie n’est pas qu’un marqueur politique : protéger le vivant et agir contre les conséquences du dérèglement climatique, c’est protéger l’humain et l’humanité, et préserver notre cohésion sociale.
L'exception sanitaire française est un nouveau cadre qui aura à traiter en profondeur les causes qui conduisent à la destruction combinée de notre santé et de notre environnement. Elle devra ainsi prendre à bras-le-corps la question des addictions. Le seul exemple du tabac est révélateur de l'ampleur du défi. Selon l'OMS, au-delà des 8 millions de décès annuels liés à la consommation de cigarettes, ce sont 600 millions d'arbres détruits, 200 000 hectares de terre attaqués, 22 milliards de tonnes d'eau perdues et 84 millions de tonnes de CO2 émises. Ce sont aujourd'hui 4500 milliards de filtres à cigarettes qui polluent nos sols, nos mers, nos rivières. Nous sommes en train de créer une société d'addiction et de frustration, et il faudra nous attaquer aux racines du mal en luttant non seulement contre le tabagisme, mais aussi contre l'alcoolisme, la dépendance aux jeux, aux écrans, au sucre. C'est un enjeu social, parce que cette société d'addiction menace notre cohésion collective et attaque les budgets des familles, un enjeu sanitaire, parce que les conséquences sur la santé des femmes et des hommes sont terribles, qu'ils soient dans une démarche d'addiction active ou qu'ils en subissent les conséquences passives, et un enjeu écologique, parce que c'est la terre que nous exploitons et nos modes de vie qui doivent évoluer.
Nous ne pouvons plus continuer à traiter la question écologique de manière sectorielle. Elle doit devenir le tamis à travers lequel passent toutes nos politiques publiques. L’humanisme est un principe, une boussole, un horizon. C’est une approche globale de la société qui assume les transversalités. Nous devons adopter l’approche « One Health » ( « Une seule santé ») , et inventer un cadre intégré qui reliera la prévention sanitaire, l’urbanisme, l’agriculture, l’énergie, l’industrie, la protection sociale et l’éducation. Ce sont là les leviers sur lesquels nous devrons nous appuyer pour construire la bifurcation écologique qui s’impose. Vivre en sécurité et vivre protégé, c’est vivre dans un cadre qui respecte le vivant dans toutes ses dimensions et qui fait de la santé publique la priorité de son action. Il en va de la dignité de toutes et de tous, et donc de tout notre modèle de société ; agir pour des citoyens en bonne santé, c’est aussi garantir la pérennité du travail, les performances économiques et le souffle productif de la nation.
Ainsi, notre politique tient en trois mots : anticiper, protéger, réformer.
Anticiper, c’est agir pour refuser d’être pris de court par des crises que nous savons inéluctables. Notre pays porte encore le traumatisme de 2020. La pénurie de masques, d’équipements médicaux et de médicaments a révélé, face à la pandémie de la Covid‑19, l’incurie d’un pays qui avait préféré, des années durant, brader sa souveraineté plutôt que de se donner les moyens d’affronter les chocs. Tirer les leçons de cette expérience, c’est construire dès aujourd’hui, non pas des outils vides de sens, mais une véritable culture de l’anticipation qui doit irriguer jusqu’au plus haut sommet de l’État. Cela suppose, par exemple, de créer un Conseil scientifique de surveillance et d’anticipation, doté de moyens propres. Il gardera un œil permanent sur les flux infectieux mondiaux, sur les déplacements d’espèces vectrices de maladies et sur les pollutions émergentes ; il coordonnera la recherche sur les maladies nouvelles et leurs traitements, et produira régulièrement des rapports d’alerte auprès des pouvoirs publics. Ce Conseil aura une mission essentielle : préparer le pays aux crises à venir. Il disposera d’une capacité de modélisation, d’un pouvoir d’alerte gradué et d’un accès en temps réel aux données hospitalières et environnementales. Nous rétablirons des stocks stratégiques de médicaments, d’équipements de protection et de solutions de refroidissement adaptées aux épisodes de canicule, et nous sécuriserons les chaînes d’approvisionnement.
Anticiper, c’est aussi agir en amont, sans délai, sur les causes identifiées et connues de la dégradation environnementale et sanitaire. L’urgence appelle des réponses immédiates et fermes pour interdire rapidement les substances les plus toxiques et accompagner les agriculteurs et les producteurs vers des cultures sans pesticides dangereux. Les labels incitatifs récompensent depuis des années les produits exemplaires sur les questions de santé et d’environnement. Le Nutri‑Score donne des informations essentielles ; il reste toutefois limité par ses critères, ce qui peut conduire à attribuer la note la plus basse à un beurre issu de l’agriculture biologique, sans distinguer entre un produit d’appoint et un produit destiné à être consommé à la cuiller. Pour aller plus loin, nous mettrons en place un étiquetage d’avertissement sanitaire et environnemental obligatoire pour les produits contenant le plus de substances toxiques, avec des pictogrammes clairs et des seuils harmonisés, complété par un affichage nutritionnel et environnemental unifié. En avertissant clairement le consommateur, nous ferons évoluer la demande et contraindrons les groupes industriels à s’adapter. Ce dispositif, bien sûr, s'appliquera aussi à la famille des cosmétiques et à tous les produits dont la consommation peut générer des troubles sur la santé et l'environnement.
De manière générale, parce que l'exception sanitaire ne saurait exister sans une transparence absolue et à tous les niveaux, il est crucial d'informer le consommateur de manière claire, lisible, nette, sur les enjeux liés à sa santé. Une sensibilisation précoce et continue permet de développer des comportements responsables et éclairés face aux risques sanitaires et environnementaux ; l'éducation à la santé ne devrait pas se limiter à l'enfance ou à l'adolescence, mais s'inscrire tout au long de la vie, afin de favoriser la prévention, la compréhension des informations médicales et la capacité de faire des choix éclairés en matière d'alimentation, d'hygiène, d'activité physique ou de consommation. Une population bien informée est mieux armée pour participer activement à sa propre santé, et par extension, à celle de la société tout entière.
J'ai l'intime conviction que la transparence est la clé du commun. Notre République souffre de ses zones d'ombres qui créent chez les citoyens l'impression de ne pas être respectés, d'être les figurants d'une pièce qui se joue sans eux. Pendant plus de quinze ans, Nestlé a mis en commerce plus de 18 milliards de bouteilles d'eau traitées illégalement, voire contaminées pour certaines par la présence au-delà des seuils de polluants éternels et de bactéries. Nous savons que cette activité illégale et dangereuse a continué après 2022 alors même que le plus haut sommet de l'Etat était au courant de ces pratiques. Nous ne pourrons pas renouer avec la confiance des Françaises et des Français dans une société du camouflage et des petits arrangements. Exigeons une transparence totale, une information libre à tous les niveaux et une publication régulière des données industrielles et productives.
Cette logique d’anticipation doit aussi traiter les causes structurelles des fragilités sociales et environnementales. Il faudra mener, sans attendre, un plan historique, ciblé et massif de rénovation thermique, priorisant les logements à la fois énergivores et occupés par des ménages modestes, afin d’en finir avec les passoires énergétiques qui condamnent des centaines de milliers de nos concitoyens à vivre au gré des fluctuations de température. Pour piloter l’action à l’échelle de tout le territoire, nous nous appuierons sur les collectivités, à commencer par les communes, premières actrices de la bifurcation écologique. Réseaux de chaleur urbains, innovations thermiques, solutions de sobriété énergétique : partout en France, des équipes municipales ont déjà développé des outils pour adapter leurs villes au dérèglement climatique. L’humanisme n’est pas macrocéphale ; nous voulons faire confiance à celles et ceux qui agissent au quotidien et accompagner leur ambition. Cette anticipation communale s’accompagnera de moyens, mais aussi d’obligations. Chaque municipalité devra établir un plan canicule opérationnel et immédiatement déployable en cas d’alerte, végétaliser ses espaces publics, protéger ses sols et sa biodiversité. En cas de manquement à des objectifs fixés par le Conseil des territoires, dont je détaillais les fonctions dans une précédente chronique, des sanctions pourront être appliquées : elles iront de la pénalité financière à la mise sous tutelle en cas de manquement grave, notamment lorsque la collectivité contribue sciemment à la surexploitation des ressources et des sols. Les territoires ultramarins, en première ligne face aux cyclones et aux maladies vectorielles, bénéficieront d’un plan d’adaptation dédié.
Il reviendra à l’État de montrer l’exemple en faisant de sa commande publique un levier de transformation. Il nous faudra réformer l'UGAP de fond en comble pour qu'elle devienne une centrale d'achat publique vertueuse qui intègre à son catalogue la question environnementale et sanitaire. Les appels d’offres, et plus encore dans la restauration scolaire ou collective, intégreront eux aussi une clause sanitaire et environnementale stricte : les titulaires devront satisfaire à des critères exigeants. Dans le même esprit, les entreprises qui réaliseront un audit global de leur exposition aux risques sanitaires et environnementaux pourront bénéficier d’un crédit d’impôt, à condition de s’engager sur un plan de réduction des risques. Les données collectées seront mises à disposition du Conseil scientifique de surveillance et d’anticipation et rendues publiques. Voilà ce qu’est l’anticipation : non seulement prévoir et voir venir l’orage, mais réorienter la puissance publique et privée vers la prévention des risques et la préparation de notre résilience. Des exercices réguliers de préparation seront organisés avec les agences régionales de santé, les collectivités et les services de secours ; ils porteront notamment sur les canicules, les feux de forêt et les crises hydriques.

La deuxième jambe de notre politique humaniste en matière d’écologie et de santé, c’est de protéger. Il s’agit de garantir à chacune et chacun, quel que soit son lieu de vie, sa condition sociale ou son métier, l’accès à une médecine de proximité exemplaire et à une véritable politique de prévention. Les déserts médicaux qui se multiplient sont notre talon d’Achille. Ils fragilisent les territoires ruraux et périurbains où vivent les plus vulnérables. Le Parlement a adopté récemment une loi visant à réguler l’installation des médecins. Désormais, l’installation devra être autorisée par l’agence régionale de santé compétente, dans un dispositif simplifié pour les zones en tension. Il ne faut pas pour autant que ce type de mesures reviennent à bureaucratiser à outrance.
J’entends aller plus loin en conditionnant l’attribution de bourses exceptionnelles aux étudiants en médecine à un engagement d’exercice dans les territoires les plus en crise. Nous accompagnerons cette mesure d’incitations non financières : accès au logement, solutions de garde d’enfants, exercice coordonné au sein d’équipes de soins primaires. Par ailleurs, nous pouvons imaginer un raccourcissement de la durée des études initiales en contrepartie d'obligations de formation tout au long de la carrière, et de décharger les médecins de tâches en les délégant à d'autres professionnels de santé. Nous ne devons pas avoir peur d’essayer et d’innover. Dès 2027, je propose d’identifier cent cinquante zones prioritaires et d’y déployer, à titre expérimental, des équipes mobiles « santé‑environnement », composées d’un médecin généraliste, d’un infirmier et d’un médiateur environnemental. Leur mission sera d’aller vers les habitants, de dépister les expositions aux risques et de proposer des solutions adaptées en lien avec les acteurs locaux de santé.
Protéger, c’est aussi agir en amont. En nous appuyant sur les infirmeries scolaires, nous organiserons pour tous les adolescents, une fois entre la classe de sixième et la terminale, un diagnostic obligatoire d’exposition aux risques, sous forme de questionnaire et d'enquête en cas de doute : qualité de l’air dans le logement, structure de l’alimentation, exposition professionnelle des parents. Au‑delà du strict aspect médical, ce rendez‑vous sera un moment de prévention et d’accompagnement. Il intégrera le repérage de la santé mentale, de l’activité physique et du sommeil, et débouchera sur des offres concrètes, par exemple l’accès facilité à des clubs sportifs, l’organisation d’ateliers de cuisine, ainsi que l’information sur la localisation des îlots de fraîcheur.
Cette prévention doit également concerner les travailleurs exposés, souvent en première ligne des risques environnementaux. Il est impératif de refonder la médecine du travail, en particulier dans l’industrie, le bâtiment et l’agriculture, d’imposer des mesures de prévention concrètes en privilégiant la substitution des produits toxiques, le captage à la source et la ventilation, de limiter les expositions prolongées aux produits chimiques, et de sanctionner les manquements. Un registre national d’exposition permettra un suivi tout au long de la carrière.
Enfin, protéger, c’est faire fonctionner ensemble ce qui reste aujourd’hui trop cloisonné. Centres de prévention, services sociaux, associations, collectivités et agences régionales de santé seront mis en réseau pour répondre rapidement aux crises climatiques et sanitaires. Un guichet unique « santé‑environnement », accessible localement et en ligne, orientera les citoyens, avec un numéro d’appel national dédié.
Dans la pensée humaniste, l’État est le garant du respect des seuils et des dignités humaines. Il est donc essentiel de repenser ses moyens d’action et d’inscrire la santé environnementale dans l’architecture même de nos politiques publiques et de nos institutions. Il ne suffit pas d’additionner des mesures isolées : il faut donner du corps et de la cohérence à l’action publique. Cela revient d’abord à repenser la gouvernance.
Les agences régionales de santé devront relever d’une double tutelle des ministères de la Santé et de l’Écologie afin de favoriser le travail transversal au sein de l’exécutif. Chaque programmation régionale intégrera la dimension environnementale dans son action sanitaire. Dans le même esprit, nous transformerons le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (COVARS) en un Haut Conseil de la santé et de l’écologie, placé sous l’autorité du Président de la République et doté de moyens garantissant son indépendance politique et privée. Il réunira médecins, scientifiques, représentants d’ONG, patients et collectivités. Sa mission sera d’évaluer l’ensemble des lois et de publier régulièrement des recommandations publiques. Ces recommandations seront rendues contraignantes dans les projets de loi de finances et dans les plans pluriannuels de santé publique. Toute nouvelle politique publique fera l’objet d’une évaluation d’impact sanitaire et climatique préalable et d’un suivi annuel.
Réformer, c’est inventer de nouveaux droits pour les citoyennes et les citoyens, protéger chacun dans sa dignité et donner à toutes et tous les moyens de se protéger, mais c'est aussi faciliter l'accès à ces droits, souvent méconnus, souvent peu ou mal utilisés. Les nouveaux outils numériques nous permettent de construire un guichet unique dans lequel seront centralisées toutes les aides, nationales ou locales, et où chaque citoyen pourra créer un compte qui lui donnera un accès facilité à leur usage. Adhésion à une coopérative alimentaire, achat d'un vélo électrique, financement de travaux d'isolation ou de purification de l'air, abonnement aux transports en commun. Ainsi, la transition ne sera plus une injonction, mais un droit accessible à toutes et à tous de manière fluide et simplifiée. Nous pourrions à terme imaginer que des « dividendes climat » soient versés directement sur ce compte unique par l'Etat ou par l'employeur et qu'il donne accès à une liste de biens et de services définis par le Haut Conseil de la santé et de l'écologie.
Le monde économique sera également concerné par la réforme. Les entreprises à fort impact sanitaire et environnemental auront l’obligation de publier chaque année leur cartographie des risques et leurs plans de réduction, sous peine de sanctions.
En parallèle, une plateforme nationale ouverte de données « santé‑environnement » centralisera l’information. Chercheurs, collectivités, journalistes, pouvoirs publics et citoyens disposeront d’indicateurs transparents pour suivre l’évolution des expositions. Le reporting extra‑financier intégrera un pilier « santé » vérifié par des tiers indépendants, conformément au principe de double matérialité. C’est ainsi que la réforme structurelle se muera en révolution de méthode et en boussole politique : davantage de transversalité, de participation et de transparence, donc davantage de responsabilité collective et partagée.
« Nous sommes face à un choix existentiel, historique et civilisationnel : investir dès aujourd’hui dans la santé écologique, ou payer demain le prix exorbitant du renoncement. »
Une telle ambition exige des moyens considérables. Mais la question n’est pas de savoir si nous pouvons nous le permettre : nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Chaque euro investi dans la prévention, dans l’anticipation et dans la protection permet d’en économiser plusieurs en soins hospitaliers, en journées de travail perdues et en vies brisées. Prévenir une maladie, c’est désengorger un hôpital, libérer un lit et donner aux médecins le droit au repos. Éviter qu’un salarié abandonne son poste en pleine période d’activité, c’est accroître la capacité de production et la rentabilité de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une dépense, mais d’un investissement à haut rendement social et économique.
Le financement de ces mesures repose sur trois principes : la justice, la conditionnalité et l’effet de levier. La justice implique de demander davantage d’efforts financiers aux secteurs les plus polluants et les plus dangereux. La conditionnalité consiste à lier toute aide publique à des engagements vérifiables, transparents et responsables en matière de santé et d’écologie. L’effet de levier, enfin, vise à utiliser chaque euro public pour attirer des cofinancements privés ou européens. Concrètement, nous mobiliserons plusieurs sources afin de tenir un budget à l’équilibre : une part des recettes de la tarification carbone sera affectée au déploiement de ces politiques essentielles ; une taxation accrue des pollutions industrielles alimentera ce fonds ; une écotaxe ciblant certains usages fortement polluants, comme les vols domestiques, complétera le dispositif. Je suis convaincu qu'un modèle vertueux profite à toutes et à tous, y compris aux groupes industriels qui construiront par leurs efforts sanitaires et environnementaux le cadre propice à leur développement futur. Il est difficile de se départir d'habitudes de prédation solidement ancrées, mais je n'ai aucun doute sur le fait que nous pouvons faire évoluer les pratiques par une évolution de la demande.
Anticiper, protéger, réformer : cette triple exigence n’est pas un luxe, mais une nécessité à tous les niveaux. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère. Continuer, c’est exposer la France, l’Europe et le monde à des conséquences dramatiques dont nous aurons peine à nous relever. Le coût de l’inaction se mesure déjà en vies perdues, en espérance de vie amputée et en milliards engloutis dans des crises évitables. Le « Quoi qu’il en coûte » n’est pas une politique de l’urgence : c’est une politique de l’anticipation. Nous sommes face à un choix existentiel, historique et civilisationnel : investir dès aujourd’hui dans la santé écologique, ou payer demain le prix exorbitant du renoncement. L’humanisme nous commande la première option. La dignité nationale nous y oblige. L’avenir nous y contraint. Construisons ensemble l'exception sanitaire française.
– Dominique de Villepin