
Nous sommes en train de changer de monde.
Nous tournons la page de l'illusion d'abondance qui a structuré le monde durant trois quarts de siècle, portée par l'exploitation des énergies fossiles et des ressources irremplaçables de la planète, par la sophistication financière d'une économie mondiale qui vit à crédit, et par la mondialisation des chaînes de production, qui a conduit en France et en Europe à faire prévaloir les consommateurs par rapport aux travailleurs.
Aujourd'hui, les limites d'un monde contraint par la triple limite écologique, démographique et géopolitique, marqué par les systèmes de prédation et de compétition, nous obligent à repenser en profondeur notre modèle social, parce qu'il vient heurter de plein fouet les équilibres sur lesquels reposaient nos sociétés depuis la Libération. Il vient bouleverser les rapports entre travail, capital et innovation, accentuant les inégalités de revenus, de patrimoines, réintroduisant la rente au coeur des leviers de fortune, fragilisant les protections et les sécurités que l'Etat-Providence avaient érigées comme des barrières depuis 1945.
Il nous faut ouvrir un nouveau chantier, pour inventer une doctrine sociale du XXIème siècle capable de répondre à ces bouleversements. J'ai repris la plume pour proposer un chemin, pour poser des réflexions, pour imaginer des pistes et des solutions. C'est une pensée en débats, en mouvement. J'entends que vous soyez le plus grand nombre à vous en saisir, pour réfléchir, avec moi, avec la France Humaniste, pour tourner la page d'un monde qui se meurt et pour imaginer ensemble le nouveau modèle social.
Nous avons un problème avec le travail. Tantôt mal compris, mal aimé, mal protégé, il peine à prendre dans le débat public la place, la force, la puissance qu'il devrait avoir. Nous avons même un empilement de problèmes avec le travail. La première strate, la plus ancienne, mais toujours à vif c’est ce que le travail comporte d’injustice, d’exploitation même, lorsqu’en échange c’est un salaire à peine suffisant qui est offert, au pouvoir d’achat sans cesse rogné par le coût de la vie. L’exigence première, c’est que le travail nourrisse son homme. Le travail a bel et bien perdu une partie de sa valeur. L'échelle des salaires nets s'est aplatie en raison des relèvements successifs du SMIC et du système socio-fiscal avec la mécanique infernale des exonérations de charges sociales et de la prime d’activité. Travailler davantage ne permet pas aux salariés, dans de nombreux cas, de gagner vraiment plus, alors que cela coûte très cher aux employeurs. Si l’on ajoute des carrières plus hachées qu’auparavant et des parcours discontinus, l'ascenseur social par le travail est en panne. Le pouvoir d’achat de la classe moyenne et ses perspectives d’avenir sont les grands perdants de la période récente.
Le chômage de masse, après 1973 nous a fait prendre conscience à tous de la cascade de catastrophes sociales qu’entraînait sa perte, pour les personnes comme pour la société. Et je m’étonne que presque personne ne parle plus de chômage, comme si le fléau avait disparu, alors qu’il se maintient constamment au-dessus de 7% de la population en âge de travailler. Le chômage de longue durée, le sous-emploi subi sont des sources d’isolement social, de mal-être psychique et de maladies chroniques. La demande légitime est d’assurer un travail à tous ceux qui peuvent travailler.
Aujourd'hui, s’ajoute à ces doutes anciens, notamment chez les plus jeunes, un motif de désenchantement. Dans les usines, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, monte la même lassitude : celle d'une société qui a tout mesuré, tout quantifié, tout contrôlé, mais qui ne sait plus pourquoi elle travaille. Les jeunes générations, exprimant ici le mal-être d'une société en perte de vitesse, refusent le sacrifice, la fatigue, la soumission à des structures qu'elles jugent obsolètes. « Déserter », ce n'est pas un rejet du travail en lui-même, mais un rejet de l’espoir trahi : celui d'un emploi qui devait émanciper, permettre de progresser dans l’échelle des revenus et dans l’échelle sociale, et qui ne le fait plus. Le sens du travail s'est également évaporé, progressivement, dans la course à la performance, les tableaux de bord, les objectifs absurdes. La société de la performance a fabriqué des vainqueurs fatigués et des vaincus résignés. Peut-être est-ce la crise du Covid qui nous aura plongé dans ce questionnement, fait sentir l’absurdité d’échelles de salaire inversement proportionnelles à l’importance collective des services rendus.
« Si le travail a perdu son sens, ce n'est pas qu'un malaise moral, c’est aussi une menace civique. Parce qu'une République n'est pas capable de survivre si elle ne reconnaît pas ses travailleurs. »
Les métiers du soin et du lien, de l'enseignement, de la solidarité, celles et ceux mêmes qui font tenir le pays et que nous applaudissions comme les « premiers de corvée » au temps du confinement se sentent abandonnés. La procédure a pris le pas sur la mission, la productivité sur la vocation et l'utilité. De façon plus générale, la qualité de vie au travail n’est pas suffisamment au rendez-vous dans les entreprises françaises dont la qualité du management se compare difficilement avec ce qui se passe dans les autres pays
Si le travail a perdu son sens, ce n'est pas qu'un malaise moral, c’est aussi une menace civique. Parce qu'une République n'est pas capable de survivre si elle ne reconnaît pas ses travailleurs. La précarité des caissières, des agents d’entretien et des aides-soignantes dont les horaires sont fragmentés et fluctuants, le surmenage des médecins et des enseignants, la fatigue des livreurs et des travailleurs de plateformes qui enchaînent les micro-contrats ou ne sont pas déclarés par leurs employeurs, les maladies chroniques des caristes et des ouvriers, les micro-entrepreneurs qui vivent dans l'angoisse permanente du mois qui vient : tout cela raconte le même déséquilibre. Ce n'est pas seulement le travail qui s'abîme, c'est la mobilité sociale qui s’éloigne et le lien social qui se défait. Les classes moyennes sont les murs de notre République et le travail cimente leurs fondations.
Que nous montrent ces malaises empilés ? Cette simple vérité que le travail n’est pas une simple marchandise qu’il s’agirait de réguler par un marché du travail parfois absurde où l’on fait mine de croire que le travail est une quantité abstraite équivalente à n’importe quel autre. Le travail est d’abord un facteur de lien social primordial. C’est le socle de la cohésion sociale et c’est en conséquence à la société tout entière de l’organiser. Il faut le dire : nous avons laissé se fissurer la promesse républicaine. Le travail devrait être la voie de la dignité pour tous les Français, il est devenu trop souvent la mesure de la précarité d’un nombre de plus en plus élevé de nos concitoyens..
Pourtant, le travail est le grand pourvoyeur de justice sociale. C’est par lui que l’on améliore le pouvoir d’achat, qu’on s’élève, que l’on contribue, que l’on appartient. C'est par lui que l'on construit une vie digne, avec du sens, avec du lien.

Replacer la justice au cœur du travail, c’est retrouver le fil de la République sociale. Cela suppose d’abord que l’État assume à nouveau un rôle d’arbitre et de stratège. Un État qui promeuve l’emploi de tous, un emploi de qualité, mais aussi une trajectoire d’ascension sociale pour les générations qui suivent. La question que nous devons nous poser est : « comment remettre le travail au centre du pacte républicain ? » D’abord, cela signifie redonner du sens au droit au travail qui figure dans le préambule de notre Constitution. Il ne saurait se résumer à l’indemnisation du chômage, aujourd’hui sans cesse remise sur le métier de la réforme. Il est nécessaire d’abandonner le projet actuel de réforme de l’assurance-chômage qui vient à contre-temps et de reprendre la concertation. Le droit au travail ne peut se résumer à un droit à la compensation de la perte de travail. Cela suppose d'inventer et d'imaginer ensemble de nouveaux instruments, solides, innovants, pour permettre l'émancipation de tous, à commencer, comme je l'ai proposé dans une chronique précédente, par fusionner les allocations chômage avec les crédits à la formation et d'autres ressources aujourd’hui dispersées pour imaginer un véritable revenu de transition et éviter autant que faire se peut le passage par la case chômage pour tous ceux qui veulent changer de métier notamment. Ainsi, nous pourrons sécuriser les parcours de vie et encourager les reconversions vers les métiers d'avenir. Mais il faut ouvrir le débat pour aller au-delà. Se cantonner à la dimension assurantielle, c’est un modèle perdant pour tous, en confiance mutuelle, en compétences, en carrières individuelles. Par ailleurs, des emplois de transition, d'intérêt public et général, et soumis à une conditionnalité stricte de recherche active d'emploi marchand pérenne, pourraient combler les besoins essentiels dans les secteurs comme l'accompagnement solidaire, la rénovation écologique, la santé, la culture, la revitalisation des villes et des centres-bourgs, et constitueraient un filet de sécurité active, évitant le chômage de masse. Ce serait aussi un investissement dans la dignité, pour offrir à tous la certitude de pouvoir contribuer, d'être reconnus, et de participer à l'effort national.
Il est également indispensable de mettre l’accent sur la lutte contre les accidents du travail, en particulier les accidents mortels qui sont beaucoup trop élevés en France qui compte avec 800 morts par an, plus du double de victimes que l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie. Sur le temps de travail, et notamment les 35 heures ou les heures supplémentaires, comme sur les retraites et en particulier afin de gérer les conséquences de la pénibilité et permettre des départs anticipés, pour sortir des débats théologiques comme ceux où l’on mélange tout, n’est-il pas possible de sortir de la cote unique et de tenir compte des exigences particulières de certains métiers – travail posté, travail de nuit, charges lourdes - et de confier davantage encore qu’aujourd’hui de responsabilités et de liberté de négociation aux branches ?
En effet, au-delà de la mobilisation sans faille de l’Etat, du Parlement – y compris le Conseil Economique Social et Environnemental, ce sont les partenaires sociaux qui peuvent et doivent jouer un rôle accru.
« Une nouvelle économie compétitive, innovante et transformatrice sera le moteur d’une nouvelle mobilité sociale et d’un nouveau partage des fruits du travail. C’est ce que j’appelle le travaillisme écologique. »
La mère des batailles, c’est retrouver le chemin de la prospérité et enraciner un nouveau modèle de croissance, fondé sur la réindustrialisation, la protection des souverainetés et la contribution à la décarbonation. Une nouvelle économie compétitive, innovante et transformatrice sera le moteur d’une nouvelle mobilité sociale et d’un nouveau partage des fruits du travail. C’est ce que j’appelle le travaillisme écologique, rendre à l'économie les moyens de faire vivre et de permettre la prospérité des filières d'avenir qui structureront notre indépendance et notre souveraineté. La pandémie a révélé une vérité brutale : un pays qui dépend des autres pour produire ce dont il a besoin ne peut se dire souverain. Chaque année, des fleurons délocalisent, des usines ferment et des centaines de milliers d’emplois se sont effacés en quarante ans. Nous avons trop longtemps cru qu’il suffisait d’importer ce que nous savions autrefois fabriquer. L’urgence écologique impose aujourd’hui l’inverse : relocaliser, transformer, réindustrialiser. L’industrie verte exige des ouvriers qualifiés, des ingénieurs inventifs, des techniciens formés aux nouveaux gestes de la transition — maintenance électrique, réhabilitation thermique, hydraulique, numérique frugal. Il faut bâtir un plan national de compétences pour la transition, associant les régions, les branches professionnelles et les universités, afin de former les jeunes et d’accompagner les salariés en reconversion. Redonner une place à ceux que le marché a exclus, c’est aussi redonner du souffle à la République. Plutôt que de coût du travail, il s’agira de revenir à la valeur travail. Le travail n’est pas une charge, c’est une création de richesse.
Ce n’est pas en comprimant les salaires que l’on redressera la France, c’est en réconciliant efficacité économique et justice sociale. Les exonérations de charges sociales patronales qui s’élèvent chaque année à environ 80 milliards d’euros constituent aujourd’hui un piège qui maintient une part importante des salariés au niveau du smic et qui aboutit à subventionner aussi bien des branches en difficulté que des secteurs en bonne santé. Il est légitime de s’interroger sur ces dispositifs. Seule une démarche plus générale de réduction du coût du travail évitera la trappe à bas salaires. Sans doute faut-il alléger les fiches de paie de l’ordre de 5 points de charges sociales patronales, c’est à dire le financement du risque famille, progressivement, à l’échelle d’un quinquennat, en les basculant vers l’imposition de la consommation et des bénéfices. Concernant les exonérations, il convient de les réduire, de les cibler sur des secteurs spécifiques et d’envisager leur conversion partielle en surcroît de revenu pour les salariés au salaire minimum.
La deuxième bataille, c’est celle de l’égalité des chances. C'est d’abord l’effort pour l'éducation et la formation, parce que c'est par elle que se joue l'égalité des chances et la préparation aux besoins de l’économie du savoir et des employeurs du futur. Tant qu’un enfant de milieu modeste aura trois fois moins de chances d’entrer dans une grande école qu’un enfant de cadre supérieur, la promesse républicaine restera inachevée. Les savoirs scientifiques, techniques et mathématiques demandent un effort particulier aujourd’hui, toutes les études le montrent. L’école et l’université doivent redevenir le grand ascenseur social, et non un miroir des inégalités, et former les jeunes générations aux compétences qui seront demandées sur le marché du travail. Cela passe par la revalorisation de l’enseignement professionnel, le soutien au logement étudiant, une orientation plus juste et plus efficace, mieux liée aux besoins réels du pays, des investissements accrus dans l’enseignement supérieur pour mettre nos universités au niveau d’excellence de leurs concurrentes à l’étranger.
L’égalité des chances ne se joue pas seulement à l’entrée dans le supérieur, mais dès les premières années d’école. Les écarts de langage, de confiance en soi et de rapport au savoir se creusent très tôt, parfois dès le CP. C’est donc là qu’il faut concentrer les efforts : programmes structurés de lecture et de langage, groupes de besoin réellement encadrés, accompagnement pédagogique continu des enseignants et interventions précoces auprès des enfants en difficulté. L’objectif n’est pas de médicaliser l’école, mais de réintroduire l’exigence et la précision dans le geste éducatif, afin que l’origine sociale ne soit plus un prédicteur automatique de réussite ou d’échec.
À partir du collège, la question devient celle des horizons possibles. Trop souvent, l’orientation rétrécit les trajectoires au lieu de les ouvrir. Il faut généraliser le mentorat, mobiliser les grandes écoles et les entreprises, et faire de l’expérience de la rencontre un droit : chaque élève doit pouvoir rencontrer un étudiant, un chercheur, un artisan, un ingénieur, un infirmier, non pas lors d’une “séance de découverte” ponctuelle, mais dans la durée. Cette approche doit s’accompagner d’un travail assumé de lutte contre les stéréotypes, en particulier ceux qui éloignent les filles des filières scientifiques et techniques. La question n’est pas seulement morale, elle est économique : la France ne peut se priver de la moitié de ses talents dans les secteurs qui structurent l’avenir.
L'école ne peut plus être pensée séparément du monde du travail. Ce cloisonnement est l’une des grandes faiblesses françaises. Il faut articuler les apprentissages à des stages systématiques d’immersion, à des projets concrets, à des parcours de découverte des métiers, pas seulement en lycée professionnel, mais dans l’ensemble du secondaire. Cela ne signifie pas subordonner l’école à l’entreprise, mais ouvrir des possibles, donner du sens, construire des repères. Les pays qui réussissent l’insertion de leurs jeunes – Danemark, Allemagne, Pays-Bas – ont rendu ces passerelles évidentes. Nous avons les outils, les expériences réussies existent : il s’agit désormais d’en faire la norme, et non plus l’exception.
C’est aussi la lutte contre les discriminations, qui est la condition de l’égalité réelle devant le travail, qu'il s’agisse de discriminations en raison de l'adresse, de la couleur de peau, du genre, du handicap, ou de la condition sociale, continuent d'exclure silencieusement des milliers de talents. C’est un scandale pour ceux qui le subissent, c’est un gâchis pour l’économie nationale. Cela suppose aujourd’hui des politiques volontaristes d’inclusion dans les entreprises.
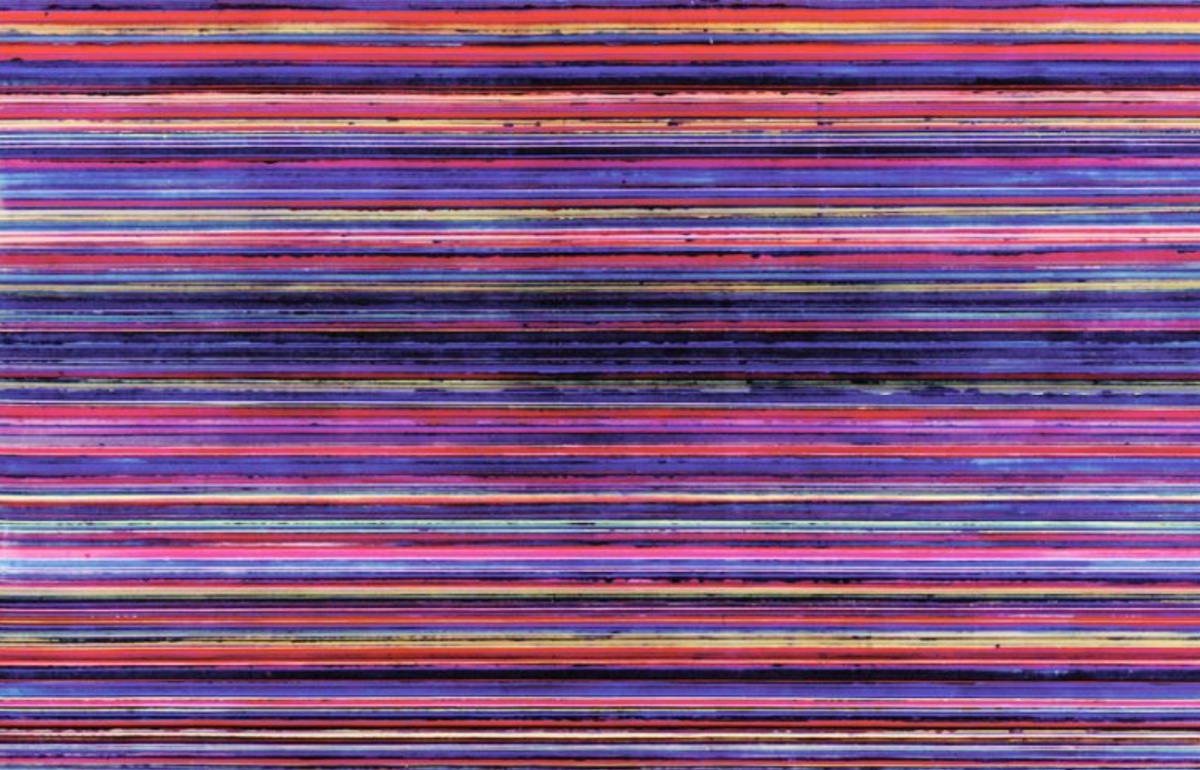
La troisième bataille, c’est la remobilisation de toutes les énergies. Il s’agit en effet non seulement de mettre le travail au centre de la République, mais aussi de remettre la République au cœur du monde du travail. Il s’agit de refonder les relations du capitalisme avec la République, de lancer le débat sans tabous sur les meilleurs moyens de les réconcilier. L’une des voies serait la généralisation de l’actionnariat salarial en nom collectif.. Cette logique attache les salariés au destin de leur entreprise mais permet aussi de protéger les entreprises d’actions hostiles extérieures en garantissant un actionnaire de référence intéressé à la préservation de l’activité. Il faut plus généralement redonner du pouvoir à ceux qui travaillent. Pendant trop longtemps, les salariés ont été exclus des décisions qui les concernent. Les derniers gouvernements ont tendu à faire du dialogue social une formalité, et de la négociation un rituel. Le temps des patrons de droit divin est révolu, il faut reconstruire une démocratie sociale digne de ce nom dans l’entreprise. Les syndicats doivent être renforcés pour apporter une contribution positive à la décision collective. Le principe général est simple : que ceux qui font l’entreprise participent à sa richesse et à ses décisions...
Le cadre du dialogue entre l’Etat et les entreprises mérite lui aussi d’être repensé. L’Etat dépense beaucoup d’argent et d’énergie dans le développement de l’économie et des entreprises. Il est naturel qu’il se serve de ces ressources pour piloter l’économie vers des objectifs d’intérêt général. Il est aujourd’hui souhaitable de contractualiser à un rythme quinquennal les avantages fiscaux des entreprises en les liant à des engagements concrets et mesurables, sociaux et économiques : parité salariale, emploi des seniors, formation des jeunes, insertion des personnes handicapées. Les entreprises y gagnent en sécurité fiscale, l’intérêt général en résultats concrets.
L’économie de marché sociale et démocratique que j’appelle de mes vœux est certes un compromis historique et stabilisateur entre libéralisme et dirigisme, mais c’est surtout un projet de commun associant toutes les parties prenantes et intégrant les externalités pour en finir avec l’illusion du tout-économique. Une économie de marché : parce que l’échange, l’innovation, la liberté d’entreprendre sont des moteurs indispensables. Sociale : parce que la richesse ne dure que si elle bénéficie à tous. Démocratique : parce qu’il est incompréhensible qu’au XXIe siècle seule l’économie échappe encore à la règle de la décision collective démocratique.
Nous devons assumer ce tournant : redonner au travail la place qu’il mérite, au capital la responsabilité qu’il doit porter, et à la société la voix qu’on lui a confisquée. Cela exige du courage politique, mais aussi un sursaut moral. Nous ne pourrons pas réparer le tissu social sans réhabiliter l’idée d’effort, de mérite, de contribution. Pas le mérite mesuré en diplômes ou en fortune, mais celui de l’utilité, du dévouement, de la solidarité.
Le véritable enjeu n’est pas économique : il est existentiel. Un pays qui ne croit plus au travail ne croit plus en lui-même. Un pays qui sépare la main de la tête, le producteur du décideur, le salarié du citoyen, finit par perdre le fil de sa communauté.
De manière générale, je pense qu'il serait utile d'accroître et de reconnaître le rôle des communes dans l'accompagnement vers l'emploi, en permettant des contrats locaux d'engagement, incluant les entreprises, les associations, les centres communaux d'action sociale, en ouvrant de vraies lignes de financements pluriannuelles, en renforçant la capacité pour les collectivités d'initier ou de co-gérer des entreprises à but d'emploi.
Il est temps de réinvestir le champ du travail pour en faire la poutre porteuse du pacte social. Favoriser le sens de l’appartenance et de l’inclusion, redonner confiance à ceux qui doutent, offrir aux jeunes un avenir qui ne soit pas fait de déclassement et d’anxiété. La République a besoin de bras et de têtes, mais surtout de cœurs engagés.
Rendre au travail son sens, sa valeur et sa fierté, c’est rendre à la Nation sa force morale.
L’économie de marché sociale et démocratique est la condition d’un nouvel humanisme républicain. Elle réconcilie la performance et la décence, la liberté et la sécurité, la responsabilité et la solidarité. Elle n’oppose pas le succès individuel à l’intérêt collectif, elle les lie. Elle ne fait pas du travail une contrainte, mais un accomplissement. Elle ne fait pas du capital un privilège, mais un engagement.
Il ne s’agit plus de choisir entre efficacité et justice, entre marché et État, entre liberté et égalité. Il s’agit de les unir dans un même projet : celui d’une République du travail et du respect. Un travail qui garantit la dignité, la solidarité, l'égalité.
Cette lucidité nous est imposée par un monde où les Empires reprennent le pouvoir ; ceux des Etats, et ceux des économies prédatrices, qu'ils prennent la forme de grandes puissances technologiques, de colonies minières ou de marchés numériques sans régulation. La France doit inventer un grand pacte, un contrat entre les forces du travail, l'Etat et les entreprises, pour faire de la production, de l'innovation et du travail des leviers d'indépendance au service de la cohésion nationale et du sursaut économique.
Et si, dans ce monde incertain, il reste un espoir, c’est bien celui-là : que la France retrouve dans le travail non pas une peine, mais une promesse. Une promesse de dignité, de fraternité et de confiance. Parce que sans travail, il n’y a pas de richesse. Et sans justice dans le travail, il n’y a pas de République.
– Dominique de Villepin